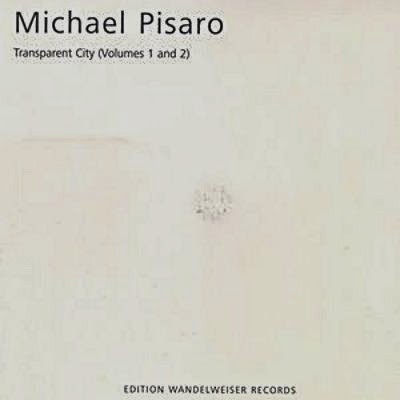Voilà plusieurs années qu'on entend de plus en plus parler de wandelweiser, aussi bien en mal qu'en bien d'ailleurs, car les détracteurs ne manquent pas. Le collectif est souvent assimilé à une utilisation immodérée du silence, de la répétition, de l'environnement extérieur et des volumes faibles. Pourtant, quand on regarde le catalogue Wandelweiser géré par Antoine Beuger, qui ne regroupe pas uniquement des membres du collectif, on s'aperçoit qu'il y a bien plus que ça, que la musique autour de ce collectif est bien plus riche qu'elle ne le laisse penser. Quelques exemples parmi les nouveaux disques proposées cette année par Beuger, qui regroupent des pièces improvisées, un opéra, une œuvre électronique, et des pièces instrumentales écrites.

Si la plupart des travaux présentés par le label wandelweiser regroupe des compositions, je ne suis pas sûr du tout que ce soit le cas pour
120112. Ce disque est un duo composé de
Rasmus Borg au piano et de
Henrik Munkeby Nørstebø au trombone, et si je ne connais pas le premier, tout ce que j'ai entendu jusqu'à présent du tromboniste appartenait clairement au domaine de l'improvisation (hormis peut-être sur son
Solo qui présentait parfois quelques lignes qui semblaient écrites au sein des improvisations).
Tout ça pour dire que je ne sais pas si c'est réellement écrit ou complètement composé, mais je crois tout de même que les trois pièces présentées ici sont des réalisations d'idées d'improvisation très restrictives. Durant cinquante minutes divisées en trois prises de son effectuées le même jour Borg et Nørstebø ne jouent que deux notes, ils ne jouent qu'une quinte dans le registre le plus grave de leur instrument. Deux notes longues et tenues, mais rondes et riches grâce aux propriétés de ce registre. Car choisir le grave et la tenue du son n'est pas un choix anodin. C'est ce qui permet également aux notes de peindre au fil de leur tenue un très large panel d'harmoniques, c'est ce qui permet à chaque son de s'élargir en fonction de son volume (qui varie entre
pp et p) et de son attaque - douce la plupart du temps.
Je n'ai pas vraiment saisi la structure adoptée par ce duo : les notes sont jouées à intervalles irréguliers, parfois seules, parfois suivies de leur pair, en solo ou en duo. Il n'y a pas beaucoup de silences, mais beaucoup d'espaces entre les notes, un espace superbement rempli par toutes les harmoniques de chaque note. Les timbres se confondent parfois, la dynamique des notes jouées simultanément est précisément similaire pour les deux instrumentistes. A noter aussi que la prise de son a été réalisée en studio, et qu'on n'entend donc aucun sons extérieurs, juste la pureté de ces quelques notes qui résonnent à chaque fois de manière toujours plus poétique. Une très belle exploration de la rencontre des registres graves du piano et du trombone au sein d'une dyade poétique. Et si c'est surprenant de voir Nørstebø sur le catalogue wandelweiser a priori, ce duo avait néanmoins toute sa place ici, il rentre parfaitement dans les "codes" wandelweiser, que ce soit écrit ou non d'ailleurs. De plus, il est vraiment beau et réjouissant.

Avec
das wetter in offenbach, ce sont
Thomas Stiegler - membre du collectif wandelweiser, et
Hannes Seidl qui proposent une pièce électronique de 40 minutes pour field-recordings et sinusoïdes. Des enregistrements quotidiens de halls, de parcs, de villes, d'oiseaux, et quelques sinusoïdes qui viennent les ponctuer. Bien évidemment, dit comme ça, ça ressemble beaucoup à du Pisaro, et pourtant pas tellement, car il n'y a pas la connivence entre les deux éléments, jusque dans le mixage, je pense que tout est fait pour les opposer.
D'ailleurs je dis sinusoïdes mais les fréquences utilisées ne sont pas aussi simples. La plupart du temps, il s'agit d'une sorte de quinte, et les deux notes sont jouées simultanément en glissando, l'une vers le bas et l'autre vers le haut. Il y a donc une confrontation à l'intérieur même des sinusoïdes. On trouve donc des confrontations entre les éléments électroniques utilisées, mais aussi une rupture vraiment surprenante. Aux alentours de 35 minutes surgit un court enregistrement de techno house complètement renversant par exemple.
Mais avec ces éléments, Stiegler & Seidl ont composé une longue pièce fleuve très belle à un volume assez fort et sans silence. D'où cette impression de forme fleuve, qui ne vient pas uniquement des enregistrements d'eau... Enregistrées entre 2009 et 2010 à Offenbach, chaque partie est mixée et éditée avec soin, il n'y a pas de ruptures claires entre chacune (hormis la fameuse partie "house" bien sûr). Tout se suit avec naturel, avec fluidité, comme dans le quotidien. Seules les fréquences en dyade viennent perturber cette quotidienneté poétique en introduisant une note d'étrangeté et de musicalité.
L'écoute de ce disque met dans un état vraiment étrange, on y cherche sa place, on y cherche la forme, on y cherche un sens. C'est une véritable expérience musicale (plus que sonore), et une expérience très belle.
Peter Streiff est un autre compositeur que j'entends ici pour la première fois. Le label wandelweiser propose ici un disque intitulé
works for piano, une suite de dix pièces réalisées par
Urs Peter Schneider, un pianiste proche du compositeur.
Je n'émettrai pas vraiment de jugement sur ce disque car je ne suis pas trop rentré dedans. Je ne trouve pas ça mauvais, mais je n'aime pas vraiment non plus, en tout cas, il n'y a pas eu le petit truc/déclic qui a fait que je m'y plonge vraiment. Ce pourquoi je ne peux pas vraiment dire quelque chose dessus. Je l'ai écouté, mais sans trop chercher à comprendre la forme, le sens, car je n'ai pas trouvé une idée forte qui m'aurait poussé à m'immerger dans ce disque.
Quoiqu'il en soit, pour présenter ce disque en bref, il s'agit d'une suite qui est assez loin des productions habituelles de wandelweiser. Ce n'est que rarement silencieux, hormis sur les
Three piano studies, ni répétitif. On a souvent l'impression d'entendre de la musique "moderne". Les formes utilisées ne sautent pas aux oreilles, c'est parfois tonal, parfois complètement atonal, parfois volontairement éclaté, et parfois structuré, en tout cas c'est écrit, semble-t-il, avec beaucoup de précision et de maturation, tout semble très réfléchi. Mais comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas, il n'y a pas eu le truc qui a fait que j'ai eu envie de me plonger dedans, et je suis resté assez distant de ce disque à chaque écoute, donc je ne peux en dire en plus. Je conseillerais tout de même d'y jeter une oreille je ne pense pas que ce soit de la "mauvaise musique", l'univers est plutôt original, les compositions semblent vraiment murement réfléchies, mais en tout cas ce n'est pas pour moi.

Mais
Urs Peter Schneider, pianiste sur le précédent disque, est également un des plus grands compositeurs "post-sériels" suisses. Et le label wandelweiser vient de publier quatre de ses compositions sur un double disque intitulé
Kompositionen 1973-1986. Certes, ce ne sont pas des compositions récentes, mais qu'importe, je suis vraiment heureux qu'elles soient enfin réalisées et publiées sur disque, et notamment l'opéra
Sternstunde, une sublime œuvre pour voix parlée, chantée et percussion. Durant 60 minutes, on entend deux cloches, deux chanteurs et trois "parleurs". Il s'agit d'une composition atonale qui est réalisée sur plusieurs couches horizontales. Les cloches jouent la pulsation, le chant n'est basé que sur une note et un rythme, et les voix parlées ne modulent également que rarement, toujours sur le même ton et légèrement en contretemps. Il s'agit donc d'une composition très lancinante et répétitive, ponctuée seulement par du bruit blanc qui intervient quatre ou cinq fois, progressivement jusqu'à recouvrir les instruments durant quelques secondes. L'atmosphère est indescriptible, il y a quelque chose de résolument ancien et médiéval, comme un chant polyphonique, et quelque chose de résolument moderne et contemporain. Mais ce n'est ni complètement moderne ni complètement ancien. Schneider maîtrise les codes et jouent avec de manière à les équilibrer, il les utilise pour créer son propre univers qui ne rentre dans aucune école. Voici donc une œuvre vraiment géniale, belle, originale, intelligente et précise, renversante. Une des plus belles pièces écrites que j'ai entendu depuis longtemps.
Hormis cet "opéra", on trouve également deux courtes pièces d'environ cinq minutes qui ouvrent et ferment chacun des disques, la première pour piano et la dernière pour orgue Hammond. La première,
Zeitgehöft, complètement atonale, est plus éclatée et utilise le silence, mais également de nombreuses variations d'attaque et d'intensité. Tandis que la dernière,
Augenhöle, utilise un volume très faible constant, de nombreux silences, et des accords harmoniques. Et le second disque est également l'occasion de (re)découvrir
Meridian, une autre très longue pièce d'une heure pour piano, violon, percussion et cuivre. Il s'agit certainement d'une œuvre sans instrumentation précise à l'origine, peut-être écrite en partition graphique. Je ne sais pas trop. En tout cas, il s'agit d'une pièce vraiment atonale, avec des cuivres et cordes qui jouent de longues notes tenues dissonantes, quelques cordes pincées plus rythmiques, et un piano aussi percussif et percutant que les percussions. La forme est insaisissable, opaque, on ne comprend pas trop la direction mais on la ressent plus - comme une partition déterminée et ouverte en même temps. Les volumes comme la densité de l'orchestre sont très variables et malléables, et l'intérêt de cette pièce réside principalement dans la gestion de l'espace, du silence et des tensions.
Un très beau disque en somme, vivement recommandé pour le magnifique
Sternstunde, mais également pour découvrir ce compositeur atypique et singulier (si comme moi vous ne le connaissez pas encore), plein d'idées et d'intelligence, injustement mésestimé.
RASMUS BORG/HENRIK MUNKEBY NORSTEBO - 120112 (CD, Wandelweiser, 2014) :
lien
THOMAS STIEGLER/HANNES SEIDL - das wetter in offenbach (CD, Wandelweiser, 2014) :
lien
PETER STREIFF - Works for piano (CD, Wandelweiser, 2014) :
lien
URS PETER SCHNEIDER - Kompositionen 1973-1986 (2CD, Wandelweiser, 2014) :
lien